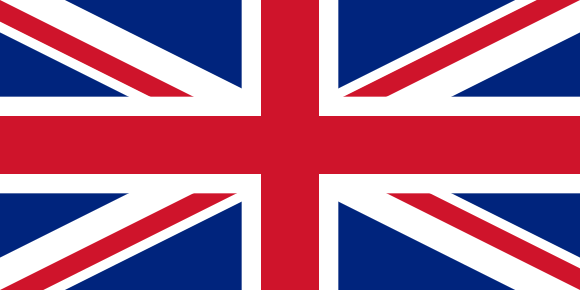Jean-Honoré Fragonard
1732 (Grasse) / 1806 (Paris)
Il convient de reconsidérer Fragonard sans le voile doctrinal d’une morale bourgeoise allègrement tartuffe et péremptoirement gardienne de bonnes mœurs dont les résurgences picotent aujourd’hui encore les diktats politiques. En commençant par rétablir les nuances dans un vocabulaire galvaudé par les scories déformées d’une langue qui tend naturellement vers la simplification. Effectivement, si le libertin s’est révélé aux jours de la Régence amant de son plaisir conçu comme simple fin, notre époque baignée de laïcité tend trop souvent à oublier la négation du catholicisme — cette religion du renoncement au corps — qu’implique l’existence toute entière des sybarites et des petites-maîtresses du XVIIIe. Sans doute ne se livrent-ils plus aux douces délectations des sens, bruyamment orchestrées durant la Semaine sainte ou le Carême, comme du temps de Théophile de Viau, Bussy-Rabutin ou du comte de Vermandois, cependant on préfère alors les boudoirs aux chapelles, ce qui détonne fondamentalement dans un pays chrétien. L’amour s’étend jusqu’à des contrées calquées sur la carte de Tendre, quand la galanterie impose un code modernisant à peine les chastes attentions du Moyen Âge courtois. L’érotisme lui-même renferme toute une prosodie amoureuse qui doit s’entendre selon une acceptation bien moins prosaïque que nous le faisons aujourd’hui, avec des raffinements sentimentaux plus tendres. N’en demeure pas moins que Fragonard illumine comme le peintre des grâces de ce siècle des Lumières amoureux.
Il convient de reconsidérer Fragonard sans le voile doctrinal d’une morale bourgeoise allègrement tartuffe et péremptoirement gardienne de bonnes mœurs dont les résurgences picotent aujourd’hui encore les diktats politiques. En commençant par rétablir les nuances dans un vocabulaire galvaudé par les scories déformées d’une langue qui tend naturellement vers la simplification. Effectivement, si le libertin s’est révélé aux jours de la Régence amant de son plaisir conçu comme simple fin, notre époque baignée de laïcité tend trop souvent à oublier la négation du catholicisme — cette religion du renoncement au corps — qu’implique l’existence toute entière des sybarites et des petites-maîtresses du XVIIIe. Sans doute ne se livrent-ils plus aux douces délectations des sens, bruyamment orchestrées durant la Semaine sainte ou le Carême, comme du temps de Théophile de Viau, Bussy-Rabutin ou du comte de Vermandois, cependant on préfère alors les boudoirs aux chapelles, ce qui détonne fondamentalement dans un pays chrétien. L’amour s’étend jusqu’à des contrées calquées sur la carte de Tendre, quand la galanterie impose un code modernisant à peine les chastes attentions du Moyen Âge courtois. L’érotisme lui-même renferme toute une prosodie amoureuse qui doit s’entendre selon une acceptation bien moins prosaïque que nous le faisons aujourd’hui, avec des raffinements sentimentaux plus tendres. N’en demeure pas moins que Fragonard illumine comme le peintre des grâces de ce siècle des Lumières amoureux.
Ses expositions
L’Empire des sens, de Boucher à Greuze
19/05/2021 - 18/07/2021
(Paris) Musée Cognac-Jay
19/05/2021 - 18/07/2021
(Paris) Musée Cognac-Jay
Amour
26/09/2018 - 21/01/2019
(Lens) Musée du Louvre-Lens
26/09/2018 - 21/01/2019
(Lens) Musée du Louvre-Lens
De Watteau à David. L’art du XVIIIe siècle dans la collection Horvitz
21/03/2017 - 09/07/2017
(Paris) Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
21/03/2017 - 09/07/2017
(Paris) Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Jardins
15/03/2017 - 24/07/2017
(Paris) Grand Palais
15/03/2017 - 24/07/2017
(Paris) Grand Palais
Joie de vivre
26/09/2015 - 17/01/2016
(Lille) Palais des Beaux-Arts de Lille
26/09/2015 - 17/01/2016
(Lille) Palais des Beaux-Arts de Lille
Fragonard amoureux. Galant et libertin
16/09/2015 - 24/01/2016
(Paris) Musée du Luxembourg
16/09/2015 - 24/01/2016
(Paris) Musée du Luxembourg